 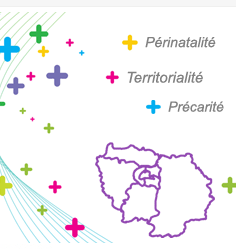 
| |||||||
|
Solidarité Paris Maman 52, rue Richer - 75009 PARIS Tél. : 01 48 24 16 28
|
Le nouveau rapport « Mortalité maternelle en France », coordonné par l’unité Inserm U953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants » Mortalité maternelle : diminution de la mortalité par hémorragies 28.11.2013 - Communiqué INSERM Le nouveau rapport « Mortalité maternelle en France », coordonné par l’unité Inserm U953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants », annonce une baisse du taux de mortalité par hémorragie du postpartum – première cause de mortalité maternelle en France – sur les données de 2007-2009 par rapport à 2004-2006. La mort maternelle est devenue un événement très rare mais reste un indicateur reconnu et fondamental de santé d’un pays et un signal à l’attention des professionnels de la santé et des décideurs, témoignant d’éventuels dysfonctionnements du système de soins. La mort maternelle est le décès d’une femme survenu au cours de la grossesse ou dans un délai de 42 jours, ou 1 an, après sa terminaison, pour une cause quelconque déterminée ou aggravée par la grossesse ou les soins qu’elle a motivés, mais ni accidentelle, ni fortuite. De 2007 à 2009, 254 décès maternels ont été identifiés, ce qui représente 85 femmes décédées par an en France, d’une cause liée à la grossesse, à l’accouchement ou à leurs suites, donnant un taux de mortalité maternelle de 10,3 pour 100 000 naissances vivantes. La nouveauté encourageante est que la mortalité maternelle par hémorragie du postpartum – première cause de mortalité maternelle en France – a diminué pendant la période 2007-2009 par rapport à 2004-2006. Selon la méthodologie améliorée de mesure, qu’il faut pérenniser, la fréquence de la mortalité maternelle est globalement stable. Il semble encore possible de la faire diminuer puisque des progrès ont été obtenus : baisse de décès liés aux hémorragies et diminution des soins non optimaux. « Ces résultats sont à mettre en rapport avec l’importante mobilisation, depuis dix ans, des chercheurs et des cliniciens, dont l’attention fut attirée par les premiers résultats de cette enquête, pour évaluer et améliorer les soins dans le contexte de l’hémorragie obstétricale. Toutefois, l’amélioration doit encore se poursuivre puisqu’environ 50% de ces décès sont considérés comme « évitables » en France, dans les conditions actuelles et l’accès généralisé des femmes enceintes à la surveillance prénatale et à des soins de qualité. » commente Marie-Hélène Bouvier-Colle, Directeur de recherche émérite Inserm au sein de l’unité Inserm U953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants ». Les facteurs de risque maternels L’âge et la nationalité maternels et la région de décès sont les principaux facteurs individuels identifiés comme liés à la mortalité maternelle. L’âge est un des facteurs déterminants de la mortalité maternelle : plus de 50% des décès concernent des femmes entre 30 et 39 ans, ce qui s’explique par le fait que les grossesses en général se déroulent à des âges de plus en plus élevés et surtout par le risque nettement augmenté de mortalité maternelle après 35 ans. Des différences significatives sont observées entre les nationalités : les femmes de nationalité subsaharienne ont le taux de mortalité maternelle le plus élevé : 22,4 pour 100 000, soit plus de deux fois supérieur à celui des femmes françaises. Selon les régions de France, les taux varient : le taux de mortalité maternelle est plus élevé que la moyenne nationale dans les départements d’outre-mer (32,2 pour 100 000) et en Ile-de-France (12,5). Les autres facteurs de risque de la mort maternelle sont l’obésité et les grossesses multiples. Les causes obstétricales de décès Les premières causes directes de mortalité maternelle sont les hémorragies obstétricales qui représentent 18% des décès, puis, ce qui est relativement nouveau, les embolies pulmonaires (11%), et les complications de l’hypertension (9%). Le grand changement concerne le pourcentage des hémorragies du post-partum qui a diminué de moitié depuis le dernier rapport (8% (1,9/100 000) contre 16% (2,5/100 000) en 2004-2006). Ce résultat encourageant est probablement dû à la mobilisation des professionnels depuis plusieurs années. Adéquation des soins et évitabilité Les soins ont été jugés « non-optimaux », c’est-à-dire non conformes aux recommandations de pratiques et aux connaissances actuelles, pour 60% des décès expertisés contre 72% entre 1998 et 2000, ce qui représente une baisse significative. Les décès par hémorragies présentent la plus grande proportion de soins non optimaux (81%). 54% des décès maternels ont été jugés « évitables », c’est-à-dire pour lesquels une modification des soins ou de l’attitude de la patiente vis-à-vis de l’avis médical aurait pu changer l’issue fatale (erreur ou retard de diagnostic, retard ou premiers secours inadaptés, traitement inadéquat, retard au traitement ou à l’intervention, et négligence de la patiente). Ce taux, stable dans le temps, reste principalement dû à une inadéquation de la thérapeutique et un retard au traitement, ce qui sous entend qu’une marge d’amélioration est possible. Ces résultats ont permis aux auteurs du rapport d’émettre 20 recommandations, parmi lesquels on peut mentionner :
Méthodologie Ce nouveau rapport a analysé les données datant de 2007 à 2009. Le précédent rapport publié en 2010 portait sur des données de 2001 à 2006. Actuellement, la France a une méthodologie spécifique pour l’identification des décès associés à la grossesse s’appuyant sur plusieurs bases de données, celles : des causes de décès, de l’état civil pour les naissances et des séjours hospitaliers. La mission du Comité National d’Experts sur la Mortalité Maternelle est d’identifier les causes des décès maternels grâce à l’information détaillée recueillie par l’enquête confidentielle menée par l’équipe Inserm 953 « Recherche épidémiologique en santé périnatale et santé des femmes et des enfants ». La procédure actuelle se déroule en 3 étapes :
Lien : Page mise à jour le 2 janvier 2014 |
|
|||||||